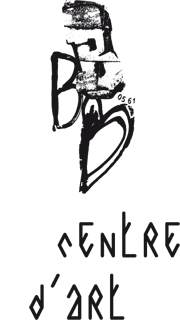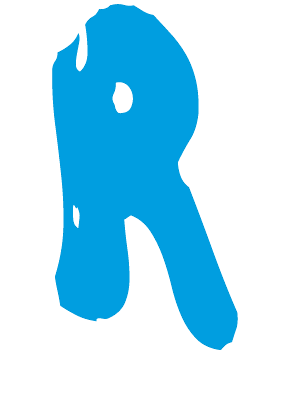
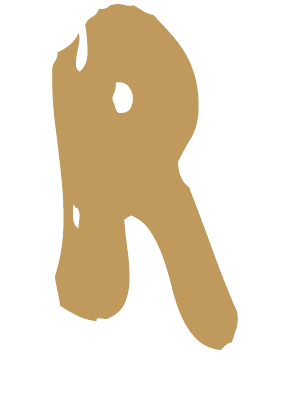




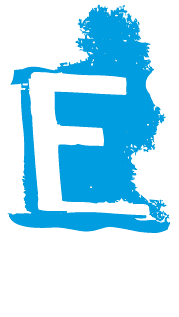
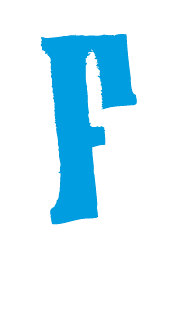

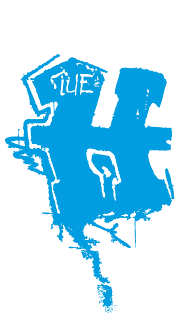
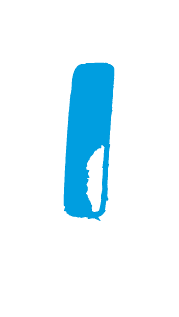
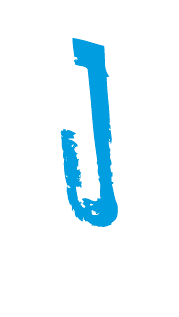
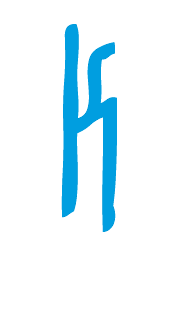





















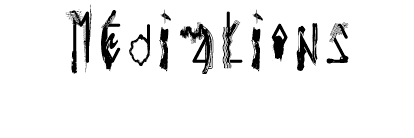

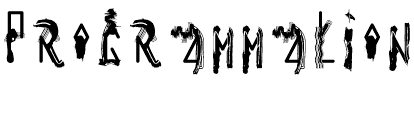

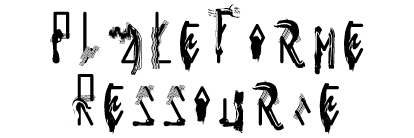


Romain Ruiz-Pacouret
Une fenêtre ouverte
Romain Ruiz a deux médiums de prédilection, la peinture et le dessin, qui correspondent à autant d’approches singulières du paysage. Alors que la première est liée à une observation et à une retranscription précise et minutieuse de son quotidien, la seconde s’inspire d’une vision fantasmée et romantique de la nature. La pratique du dessin est d’ailleurs vue par l’artiste comme une échappatoire, une façon de revenir à la spontanéité du geste et des matériaux. En somme, un degré zéro de la peinture.
Alberti disait de la toile qu’elle est une fenêtre ouverte sur le monde. C’est un point de vue que semble avoir adopté Romain Ruiz à travers sa série de tableaux intitulé Mon horizon embrumé, qui représente des vues de paysages urbains aperçu depuis les carreaux de sa chambre, située en banlieue parisienne. Celle-ci donne sur le périphérique, ainsi que sur de nombreuses tours d’immeubles délavées, ruines de notre ère postindustrielle. Malgré le caractère disgracieux de cet horizon, l’artiste arrive à en transfigurer l’essence pour lui insuffler un peu d’humanité. Passé au filtre de la subjectivité, ce paysage parcouru tant de fois du regard devient un sujet d’évasion et de douce rêverie. C’est bien ainsi qu’il faut entendre la métaphore d’Alberti : la peinture doit donner du paysage une représentation juste et conforme au réel, quitte à tromper l’œil de l’observateur. C’est la fameuse question de la mimésis ou de l’imitation du réel qui a depuis fait couler beaucoup d’encre.
Romain Ruiz a compris pour sa part que la peinture avait échoué à cette tache depuis l’apparition de la photographie. C’est d’ailleurs de celle-ci qu’il s’inspire pour composer ses dessins. Piochant dans des catalogues d’expositions ou des livres portant sur le Land art, il retranscrit l’environnement tout en oblitérant l’œuvre. Ne reste que le décor, que la nature vierge sans aucune trace de l’intervention de l’homme. Ce geste d’une apparente simplicité permet de questionner la valeur documentaire de ces photographies, qui sont la plupart du temps exposées en remplacement des œuvres éphémères ou inaccessibles. Par ailleurs, dans une autre série de dessins, l’artiste use du procédé inverse. Attaché à la marche comme forme méditative de réflexion, il arpente les Pyrénées à la recherche d’un nouveau cadre, d’un dépaysement. Il immortalise ses moments de découverte et d’émerveillement par le biais de la photographie, qui lui sert ensuite de support. Une fois imprimées, ces images sont patiemment retranscrites au fusain. À ces environnements déserts, souvent inhospitaliers, il ajoute pour finir des formes géométriques minimalistes empruntées à Sol Lewitt, Tony Smith, Carl André ou Robert Morris. S’il y a encore une fois rappel de la valeur mémorielle et testimoniale du document, ce n’est que pour attester d’un processus de distanciation d’autant plus fort qu’il introduit une forme de fiction. Ainsi le dessin devient un territoire de projection et de prospection mental.
Septembre Tiberghien, critique d’art
_ texte commandé dans le cadre de « Première 2013 », une exposition collective et un catalogue coproduits par le centre d’art contemporain de Meymac et BBB centre d’art - 2014
_ en partenariat avec les Écoles nationales supérieures d'art de Bourges et Limoges, l'École supérieure d'art de Clermont Métropole et l'Institut supérieur des arts de Toulouse